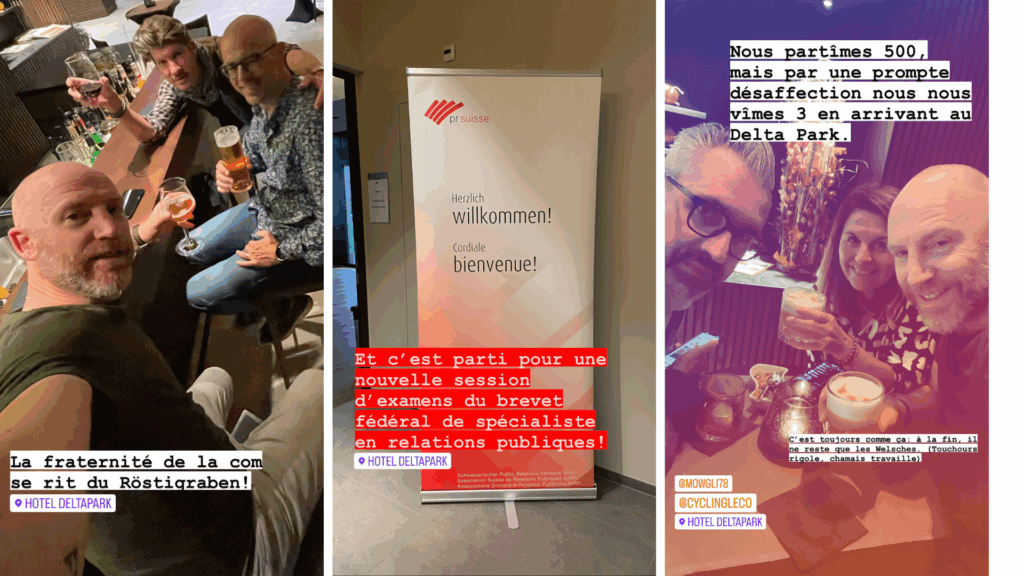Aujourd’hui, c’est un peu spécial. Je rentre du Deltapark Hôtel sur les bords du Lac de Thoune. C’est là que chaque automne depuis 2019, je joue l’expert pour les examens de spécialiste en relations publiques. Mais c’est la dernière fois que je faisais le voyage: le brevet fédéral va disparaître.
Depuis plusieurs années, on assiste à une baisse du nombre de candidatures telle que l’organisation des examens n’est plus viable. Après de nombreuses délibérations, notre association faîtière PR Suisse a décidé de la fermer. Les débats étaient intenses, les points de vue assez polarisés. Je fais partie de la faction minoritaire qui a défendu le brevet jusqu’au bout.
Mais ça sert à rien de revenir sur les raisons de cette décision. Aujourd’hui, je veux surtout parler de ce que ça signifie pour notre métier: les relations publiques et la communication institutionnelle.
Ma crainte, c’est que la fin du brevet remette en question un élément qui fait à la fois la grande force et la plus grande faiblesse de la profession: sa diversité. Je m’explique.
Le métier n’est pas protégé, souvent mal connu et compris par celles et ceux qui lui font appel: les client-es ou la direction des organisations. Ce qui fait qu’aujourd’hui, n’importe qui peut s’improviser communicant-e. C’est évidemment un problème quand des personnes qui se revendiquent ainsi du métier agissent de façon peu qualitative ou carrément inacceptable sur le plan déontologique. C’est un problème, parce que ça discrédite toute la profession.
Une profession riche par sa diversité
Mais si on met de côté cette minorité de comportements problématiques, cette diversité est un super avantage. Aujourd’hui, le métier rassemble des gens de plein d’horizons différents, avec des bagages professionnels très variés qui se compètent et s’enrichissent mutuellement.
On a des communicant-es qui viennent des milieux de vente, du droit, de la géographie, des sciences politiques, du graphisme, de la pub, du journalisme, de la diplomatie, des RH, des filières scientifiques, du monde médical, d’etudes en histoire ou en théologie, du travail social, du web, de la radio, du théâtre, etc. On a des jeunes qui sortent des études et des personnes qui ont de la bouteille.
Le brevet comme tronc commun pratique
Pour un métier aussi humain, complexe et ancré dans les tendances sociétales que le nôtre, cette richesse de points de vue et de savoirs est un atout… pour autant qu’elle soit mise à profit correctement.
Je suis convaincu que le brevet permettait exactement ça. Il permettait à des personnes formées dans d’innombrables autres domaines d’utiliser leurs compétences et leurs outils dans des projets de communication, avec une méthodologie commune et, mine de rien, une approche stratégique. Je le sais: je l’ai vécu. Grâce au brevet, j’ai pu transformer mes compétences de juriste, mon goût pour les histoires et pour la rédaction en autant de cordes à mon arc de communicant.
Alors sans brevet, qu’est-ce qui risque de se passer? Je vois deux choses: une uniformisation des profils ou une déprofessionnalisation du métier. Peut-être les deux.
Des profils uniformisés
La perte d’intérêt pour le brevet fédéral vient de la concurrence des filières académiques qui ont émergé un peu partout après le lancement du premier master à l’université de Lugano il y a une vingtaine d’années. Ça veut dire que désormais, le métier sera ouvert en priorité à des personnes qui sortent des universités et des HES. C’est sûrement des bons profils, mais on va perdre la diversité actuelle qui est une richesse.
Et on va quand même perdre une approche fondée sur la pratique professionnelle, ce qui n’est pas une bonne chose. L’acquisition des bonnes pratiques et d’une expérience valable dépendra de l’encadrement des jeunes professionnel-les pendant leurs premiers postes. Et connaissant le marché actuel en Suisse romande, je suis quand même assez pessimiste.
Une déprofessionnalisation du métier
A côté de ces professionnel-les issus des filières académiques (et donc assez théoriques, qu’on le veuille ou non), il va rester des profils qui voudront bosser dans la com. Parce que notre métier attire, parce qu’il fait l’objet de fantasmes, parce qu’il a l’air cool. Ces personnes au bagage moins académique rencontreront deux problèmes. D’abord, elles seront moins bien considérées et donc probablement reléguées à des rôles subalternes, ce qui les empêchera de mettre à profit leurs compétences et leurs domaines d’expertise antérieurs.
Et sans brevet, elles devront attendre d’avoir acquis assez d’expérience pour s’inscrire à un DAS (5-10 ans de métier en moyenne pour les participant-es). Ça leur laissera assez de temps pour acquérir des mauvaises habitudes. Et peut-être que le DAS ne sera jamais une option: trop cher pour des subalternes, et finalement incapable de former assez de monde: en gros, les deux DAS actuels de Suisse romande produisent seulement une trentaine de diplômé-es par an.
L’importance des associations professionnelles
La fin du brevet, ça veut dire que l’existence et les activités des associations professionnelles deviennent primordiales pour la cohésion de nos métiers. La Société romande de relations publiques organise chaque année 10-12 événements où les pros des RP et de la communication institutionnelle de toute la Suisse romande peuvent réseauter, échanger des bonnes pratiques, acquérir de nouveaux outils ou des nouvelles méthodologies, se tenir au courant des tendances et trouver l’inspiration grâce à des conférencier-es. En l’absence d’un tronc commun de formation, c’est vraiment essentiel!
Mais dans tous les cas: oui, je vais regretter le brevet. Je regrette qu’on n’ait pas pu en faire une sorte de passage obligé pour le début de carrière, comme c’est le cas pour les experts comptables ou les experts fiscaux. Et je regrette les bons réflexes et la bonne méthodologie qu’il aura apportés à tant d’entre nous ces dernières décennies.
Ça, et les super bons moments entre expert-es des deux côtés du Röstigraben, bien sûr 😅